A
Anonymous
Guest
J'ai cherché par mots-clés et je ne crois pas que ce texte ait circulé sur le forum, même s'il date de 2002 : http://www.ethnographiques.org/2002/Blondeau
Il s'agit de l'expérience d'une, alors jeune, étudiante en ethnographie qui, travaillant en tant que caissière dans une boucherie est devenue végétarienne, a choisi de travailler pour sa licence/maîtrise/DEA sur la boucherie et a fini par redevenir omnivore en devenant bouchère elle-même dans le cadre de son observation participante.
Malheureusement, le texte est très long, donc je résume (de façon très barbare) son propos ici. Il est très intéressant sur la mise en place symbolique et technique du déni et du carnisme. Son hypothèse est que l'abattage seul ne suffit pas à transformer l'animal en aliment consommable (à le "désanimaliser"), mais que c'est bel et bien sur l'étal du boucher que l'animal est transformé en viande, qu'on "neutralise", camoufle le cadavre. Dit comme cela, ça semble évident, mais elle décrit par le menu comment ça se met en place : quels morceaux sont conservés ou non, comment sont transformés certains morceaux trop "animaliers" et pas d'autres, comment tout ce travail est en toute conscience effectué à l'arrière pour ne pas choquer le consommateur. Ce sont tous ces gestes qui désincarnent l'animal, presque de façon rituelle, permettant de lever le tabou (elle n'emploie cependant pas ce terme) qui consiste à tuer un être vivant auquel on est susceptible de s'identifier car êtres vivants nous aussi, pour s'alimenter.
Encore mieux, elle décrit que les bouchers eux-mêmes sont souvent sensibles à ces actes, comme en atteste le fait qu'ils n'acceptent pas de rendre visible ce travail, refusent les photos, sont attachés aux notions de propreté (et pas seulement d'hygiène : il faut que ce soit présentable aux yeux extérieurs) de l'étal et de leur blouse, etc. Il veulent "rester propres" face au regard de l'autre ; ils se camouflent derrière un discours technique presque présenté comme une déontologie professionnelle (pas sans rappeler le tabou social sur les bourreaux d'ailleurs).
Du coup, c'est assez perturbant son expérience. De son approche, il me semble qu'il ressort que les bouchers et les végés ont ceci de commun qu'ils ont retiré leurs oeillères et sont sortis du déni carniste. Ils partagent un "langage" à défaut d'une éthique (puisque les uns engendrent le système quand les autres le rejettent). Je trouve toutes ses analyses et observations particulièrement éclairantes et très complémentaires du peu que j'ai pu lire du travail de Melanie Joy sur le dispositif carniste.
Seul souci : elle est redevenue omni après avoir été végé, en toute conscience, en sachant ce qu'il y a derrière. Par empathie avec les bouchers, dit-elle, dont elle croyait naïvement qu'ils étaient des monstres sans coeur. Comme si elle était devenue végétarienne parce qu'elle trouvait les bouchers inhumains... Comment est-ce possible intellectuellement de pousser le décorticage du carnisme à un niveau aussi élevé, de démonter ses mécanismes, de les comprendre, les identifier et de revenir malgré cela au régime omnivore ? Comme si elle était plus sensible à la souffrance animale en étant encore un peu dans le déni elle-même qu'une fois en pleine lumière.
Je mets du coup quelques passages clés, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas le temps, comme c'est vraiment très long :
Sur son rapport au terrain, à l'empathie, au végétarisme :
Sur la désincarnation de l’animal :
Il s'agit de l'expérience d'une, alors jeune, étudiante en ethnographie qui, travaillant en tant que caissière dans une boucherie est devenue végétarienne, a choisi de travailler pour sa licence/maîtrise/DEA sur la boucherie et a fini par redevenir omnivore en devenant bouchère elle-même dans le cadre de son observation participante.
Malheureusement, le texte est très long, donc je résume (de façon très barbare) son propos ici. Il est très intéressant sur la mise en place symbolique et technique du déni et du carnisme. Son hypothèse est que l'abattage seul ne suffit pas à transformer l'animal en aliment consommable (à le "désanimaliser"), mais que c'est bel et bien sur l'étal du boucher que l'animal est transformé en viande, qu'on "neutralise", camoufle le cadavre. Dit comme cela, ça semble évident, mais elle décrit par le menu comment ça se met en place : quels morceaux sont conservés ou non, comment sont transformés certains morceaux trop "animaliers" et pas d'autres, comment tout ce travail est en toute conscience effectué à l'arrière pour ne pas choquer le consommateur. Ce sont tous ces gestes qui désincarnent l'animal, presque de façon rituelle, permettant de lever le tabou (elle n'emploie cependant pas ce terme) qui consiste à tuer un être vivant auquel on est susceptible de s'identifier car êtres vivants nous aussi, pour s'alimenter.
Encore mieux, elle décrit que les bouchers eux-mêmes sont souvent sensibles à ces actes, comme en atteste le fait qu'ils n'acceptent pas de rendre visible ce travail, refusent les photos, sont attachés aux notions de propreté (et pas seulement d'hygiène : il faut que ce soit présentable aux yeux extérieurs) de l'étal et de leur blouse, etc. Il veulent "rester propres" face au regard de l'autre ; ils se camouflent derrière un discours technique presque présenté comme une déontologie professionnelle (pas sans rappeler le tabou social sur les bourreaux d'ailleurs).
Du coup, c'est assez perturbant son expérience. De son approche, il me semble qu'il ressort que les bouchers et les végés ont ceci de commun qu'ils ont retiré leurs oeillères et sont sortis du déni carniste. Ils partagent un "langage" à défaut d'une éthique (puisque les uns engendrent le système quand les autres le rejettent). Je trouve toutes ses analyses et observations particulièrement éclairantes et très complémentaires du peu que j'ai pu lire du travail de Melanie Joy sur le dispositif carniste.
Seul souci : elle est redevenue omni après avoir été végé, en toute conscience, en sachant ce qu'il y a derrière. Par empathie avec les bouchers, dit-elle, dont elle croyait naïvement qu'ils étaient des monstres sans coeur. Comme si elle était devenue végétarienne parce qu'elle trouvait les bouchers inhumains... Comment est-ce possible intellectuellement de pousser le décorticage du carnisme à un niveau aussi élevé, de démonter ses mécanismes, de les comprendre, les identifier et de revenir malgré cela au régime omnivore ? Comme si elle était plus sensible à la souffrance animale en étant encore un peu dans le déni elle-même qu'une fois en pleine lumière.
Je mets du coup quelques passages clés, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas le temps, comme c'est vraiment très long :
Sur son rapport au terrain, à l'empathie, au végétarisme :
La participation au, et le partage du, monde des acteurs permet de recourir à l’empathie et à l’intuition pour en comprendre les enjeux. La situation favorise l’intercompréhension, tant avec les consommateurs carnivores (que j’ai même rejoints depuis plus d’un an) qu’avec les bouchers. Ces derniers ne sont pas des extra-terrestres ni des barbares. Contrairement à ce que pouvait se plaire à croire la jeune végétarienne que j’étais, un boucher est un homme comme les autres, un homme parmi les autres. Il n’est pas inhumain comme il n’est pas inanimal. La dichotomie commode n’opère plus. Si le boucher ne peut se dérober à une besogne faite d’os, d’entrailles et de sang, il ne s’y réduit pas. Il la dépasse dans la manifestation d’une compétence qui habilite ses gestes et dans l’affirmation d’une connaissance qui neutralise l’animal ; lequel devient une matière première à laquelle il faut donner une vie, toujours pensée vers l’aval. L’animal, sa mort et sa mise en viande sont des étapes de transmutation d’une même matière.
La viande « traduit » (Callon, 1986), fédère des attitudes différentes qui s’ignorent mais ne sont cependant pas si lointaines. Parallèlement aux deux logiques coexistantes entre sarcophages et zoophages [2] à l’égard du régime carné que Noëlie Vialles (1988) analyse en terme de négation contraire, par excès ou par défaut, j’analyse les attitudes du professionnel boucher et du consommateur carnivore en ces mêmes termes. Par excès, c’est le comportement majoritaire du carnivore « chez qui l’identification avec l’animal conduit au refus de le reconnaître dans la chair qu’il consomme ». Par défaut, c’est le comportement du boucher « pour qui l’identification de l’animal dans la chair est possible, parce que l’animal est à ses yeux déjà aliment » (1988 : 93). Chacun à sa manière se donne ainsi les moyens d’oublier le rapport entre animal et alimentation carnivore : le boucher par sa confusion entre bête et viande, le consommateur par son refus de certaines parties - le sang, les os et les abats (voir plus bas) - qui posent de la façon la plus visible (trop) le problème de l’identification à l’animal (au semblable), le végétarien [3] par son abstention de toute consommation carnée.
Sur la désincarnation de l’animal :
L’abattage des bêtes pose le problème métaphysique de la mort en général puisque l’homme et l’animal partagent un statut d’être vivant [7]. Ainsi l’enjeu de l’opération d’expulsion du sang réside dans la séparation entre animal et aliment, et entre bête et homme. C’est pourquoi nous ne consommons pas d’animaux morts accidentellement, dans lesquels le sang est présent ou a stagné ; autrement dit dans lesquels l’âme, la vie animales sont présentes. Conformément à l’adage « nous sommes (devenons) ce que nous mangeons », nous devons savoir comment a vécu et comment est morte la bête que nous consommons.
La mise à mort n’est qu’une des premières étapes de transformation de l’animal en viande consommable. Autrement dit la saignée ne suffit pas à rendre l’animal propre à la consommation humaine, elle est le premier moment de désanimalisation qui rend possible toutes les phases de désanimalisation ultérieures. Lesquelles phases se déroulent et se poursuivent en boucherie. Si la société essaie d’euphémiser le temps de la mort (Vialles, 1987), elle tente aussi d’édulcorer la confrontation avec son incarnation, avec la transformation de la carcasse en viande. Si l’homme ne veut plus voir la mise à mort, il ne veut plus non plus voir le corps animal. La disjonction entre carcasse et viande, par ces opérations de transformation invisibles, est assez fondamentale pour s’inscrire dans l’espace de la boucherie : le derrière caché in-montré au consommateur, et le devant montré, l’étal. Comme je l’explique par ailleurs (Blondeau, à paraître), le système d’organisation de l’espace boucher est une métaphore de la consommation distanciée des carnivores.
La boucherie, un lieu d’innocence ? Elle est une mise en pièces de ce corps animal - ou (pour) une mort sans cadavre - par le pouvoir de transformation dont s’est doté le boucher. La boucherie est le lieu où entre la carcasse et d’où ressort une viande propre à la consommation humaine, prête à être cuisinée.
Prendre en photographies ces tâches et traces de sang sur la table de travail ou sur le tablier équivaut-il à prendre le boucher ou le charcutier en flagrant délit d’immoralité ? La prise de ces images s’apparente à un test. Elle révèle (s’il fallait encore le montrer) qu’il y a bien quelque chose à cacher (de caché) en boucherie. Pour preuve tout sang visible provoque problème, qui se réfère à l’activité bouchère marginale, censurée (ce que la méthode photographique employée révèle admirablement). S’il est in-montré c’est parce qu’il est in-montrable. Tant pour les consommateurs que pour les bouchers.
Si ces derniers ne peuvent ignorer sur quoi ils travaillent par leur corps à corps avec les carcasses, ils font tout pour. Ainsi interroger les carnivores consommateurs et bouchers sur ce qu’ils font, en d’autres termes sur ce qu’ils mangent et sur ce qu’ils travaillent - autrement dit sur l’animal - revient à les prendre au dépourvu, à leur demander de regarder là où ils ne le veulent pas. Chez tous mes informateurs, la volonté de conserver une image de la viande, et une image de la viande plus anonyme pour le client, revêt une importance toute particulière puisqu’il s’agit en somme de prouver (se prouver) que la viande que l’on travaille et/ou que l’on mange n’a rien de commun avec l’animal qui souffre, qui meurt pour nous.
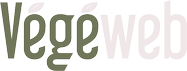
 ).
).