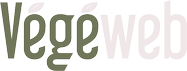Mais au delà de l’hypothèse, est-ce qu’un biais à propos de la conception de l’espèce a été mise en évidence
Il ne faudrait pas perdre de vue la question de fond. En tant que véganes (antispécistes ou non), notre problème est celui de la construction de relations d’égalité et de solidarité avec les animaux, notamment sur des fondements éthiques clairs et solides. L’antispécisme n’a pas vocation à réfuter la notion d’espèce dans l’absolu. En revanche, si des travaux font état d’interventions en faveur de l’égalité animale en se fondant sur la classification des espèces, je veux bien les lire.
Pour répondre à ta question à partir d’un exemple concret, un grand nombre de travaux scientifiques sur la définition des « espèces invasives » (notion intégrée aux politiques européennes), sont de part en part traversés par des représentations anthropocentrées et normatives que des antispécistes ne pourraient pas reprendre à leur compte. Voici, par exemple, le passage d’un texte scientifique traitant des « espèces invasives » : « Invasive species such as the zebra mussel (Dreissena polymorpha), which can clog water pipes for electric power plants and municipal and irrigation water supplies, cause tangible economic damages (...) Taken alone, the estimated economic damages resulting from individual invasive species can be significant. For example, since its introduction, the unpalatable weed, leafy spurge (Euphorbia esula), has spread to more than 5 million acres of rangeland in the northern Great Plains, causing estimated production losses, control expenses, and other economic damages in excess of $100 million per year (...) Recent studies that have attempted to estimate the total national impact of invasive species also suggest that the overall magnitude of annual eco- nomic change exceeds the federally-defined threshold of $100 million per year for “major” economic impacts » (« Risk Assessment for Invasive Species », New Mexico State University, Department of Fish, Wildlife and Conservation Ecology, 2004).
Je laisse apprécier la tonalité de ces passages où la notion d’ « espèces invasives » est utilisée de manière objectiviste et normative : les auteurs ne se posent à aucun moment la question de leur rapport à l’objet et ne voient pas que ce qu’ils en disent est déterminé par une vision anthropocentrée de l’intérêt collectif, ici économique. Et je pourrais multiplier les exemples à partir d’autres textes. Imagine-t-on des antispécistes mobiliser un tel discours ? J’ai la faiblesse de croire que le sujet serait traité différemment, à commencer par une critique de cette notion d’ « espèces invasives ».
l’antispécisme ne résoud pas le problème, on ne peut devancer cette inertie, càd cette absence de connaissance.
Ce n’est pas ce que je dis. Une taxinomie officielle (la classification des espèces) présente un ensemble de savoirs stabilisés et donc relativement figés par rapport à la science en train de se faire, là où une conceptualisation souple et immédiatement contextualisable (par ex. les « animaux liminaires ») permet de poser de bonnes questions et de résoudre des problèmes dans une perspective qui tend à être celle de la solidarité et de l’égalité animales.
Il ne faut pas confondre une taxinomie officielle et le dernier article de la revue Nature, de même qu’on ne confond pas la langue du dictionnaire de l’Académie et la langue parlée.
C’est à dire? Je comprends mal ta demande?
J’ai l’impression que nos questions s’éloignent du paradoxe que soulevait le message initial de Zigzag (que nous avons résolu il me semble) et tendent de plus en plus vers une critique tous azimuts de l’antispécisme, sans proposer pour autant une alternative cohérente.
Pour ma part, outre la clarification de la notion sous-jacente d’égalité et les conséquences pratiques (en termes de droits notamment) de l’antispécisme, j’ai évoqué les raisons de mon attachement à cette étiquette qui renvoient à la fois à un principe de modestie devant le foisonnement et la complexité du corpus antispéciste, à une posture critique vis-à-vis des usages discriminants, et dans certaines circonstances croisés (genre, race, classe), de la classification d’espèce, et enfin à une définition de la « question animale » permettant d’écarter des hypothèses fantaisistes (par ex. un vitalisme intuitif généralisé) et s’articulant au véganisme sans s’y substituer.
Pour le reste, on trouve de nombreux ouvrages sur l’antispécisme, et pour débuter la synthèse de Valéry Giroux (L’antispécisme, PUF, Que sais-je, 2020) qui, bien que brève, présente des éléments de réponse à beaucoup de nos questions.
Pour y voir clair et me faire une idée, j’aimerais donc lire une ou des références de travaux présentant les vertus que tu as évoquées dans tes messages précédents : vitalistes avec cette idée de « gradient de considération éthique », traitant de la question animale sans « prisme militant », mais avec des « applications précises », des avancées « conceptuelles flagrantes », et fondés sur une définition scientifique, actualisée et non discriminante de l’espèce.